Originaire de Benin City, au Nigéria (le « cœur battant de la nation »), elle étudie la migration et la mobilité de la main-d’œuvre, et aborde avec nuance et dans une optique mondiale les questions de droit, de justice et de dignité humaine.
Au centre de ses travaux de doctorat : les accords bilatéraux sur la main-d’œuvre, ces ententes internationales qui régissent les mouvements des travailleuses et des travailleurs migrants. La doctorante examine ces accords non pas comme de simples contrats techniques entre États, mais bien comme des instruments qui influencent profondément la vie des gens. En étudiant les accords bilatéraux sur la main-d’œuvre dans une perspective postcoloniale et féministe, elle constate que le droit migratoire reflète et reproduit les structures de pouvoir, et que d’autres cadres, ancrés dans les vécus africains d’hier et d’aujourd’hui, pourraient produire des résultats plus équitables pour les travailleurs, et en particulier pour les travailleuses.
Dans l’entretien qui suit, Christiana nous parle de son parcours en recherche, des communautés qui le soutiennent et des raisons qui l’amènent à remettre en question le vocabulaire « neutre » du droit international.
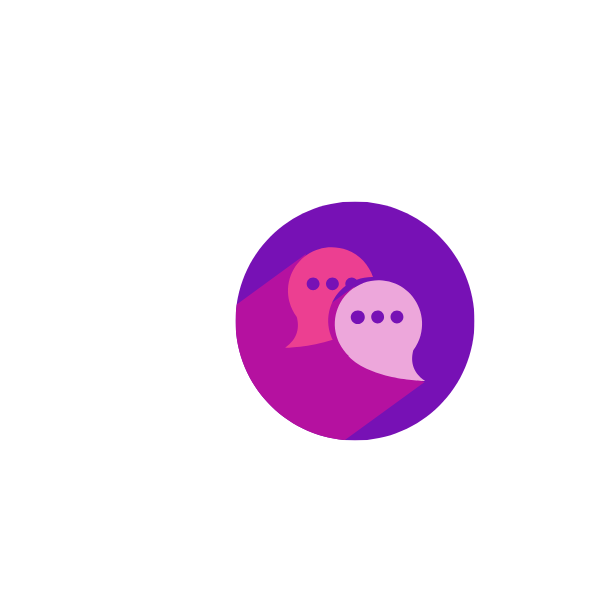
« D’abord et avant tout, je veux montrer que les ABMO sont plus que des contrats. Ce sont des instruments qui influencent la vie des gens et qui devraient être conçus en fonction de cette réalité. »
Christiana Sagay
Parlez-nous un peu de vous et de ce qui vous a menée à étudier à l’Université d’Ottawa.
Christiana Sagay : Il n’est jamais facile de résumer qui je suis en quelques mots. Je porte de nombreux chapeaux et, pour différentes personnes, je représente des choses différentes. Mais s’il y a deux qualités qui ont constamment façonné mon parcours, ce sont la curiosité et la créativité. La curiosité m’a toujours poussée à poser des questions difficiles, parfois inconfortables, tandis que la créativité m’a guidée pour imaginer de nouvelles façons d’y répondre. Ensemble, elles ont défini ma manière de voir le monde et la façon dont j’ai choisi d’y évoluer.
J’ai grandi à Benin City, dans l’État d’Edo, au Nigéria, « le cœur battant de la nation ». Son énergie vient autant de son histoire que de sa géographie : la richesse culturelle du royaume du Bénin, sa position centrale comme carrefour, et sa réputation de lieu en constant mouvement. Avoir été élevée là-bas m’a appris à voir le monde comme un ensemble de couches complexes, rempli d’histoires qui ne demandent qu’à être racontées. Bien que mon père soit ghanéen, je me suis toujours identifiée comme une fille bini. Mais en vérité, les racines ghanéennes de mon père ont ajouté une autre dimension, m’amenant à concevoir l’identité comme à la fois locale et mondiale.
Lorsque je suis arrivée à Ottawa, j’ai ressenti une familiarité inattendue. La ville, avec son mélange de langues, de cultures et de traditions, semblait refléter le monde dans lequel j’avais grandi et certains des autres endroits où j’ai vécu. C’était comme un autre point de rencontre, un lieu où les histoires et les identités se croisent – un peu comme « l’ancienne cité de Benin », comme on l’appelle, mais avec un nouveau rythme. Ce sentiment de reconnaissance m’a attirée vers l’Université d’Ottawa, où j’ai trouvé l’espace pour explorer certaines des questions qui m’animaient depuis longtemps.
D’une certaine manière, je dirais que poursuivre mon doctorat ici représente la continuité d’un parcours de toute une vie. Et cela me semble être le prolongement naturel de qui je suis et des valeurs que je porte avec moi.
Sur quoi vos travaux portent-ils? Et qu’est-ce qui vous a poussée à explorer ce sujet?
C.S. : Je m’intéresse à la mobilité transnationale des travailleuses et des travailleurs qui migrent vers et depuis l’Afrique, plus précisément les accords bilatéraux sur la main-d’œuvre (ABMO). Je m’intéresse aux tensions entre la diplomatie migratoire (comprise comme une forme de négociation entre États et de stratégie quant à la politique étrangère) et la protection des droits de la main-d’œuvre migrante sur le terrain. J’ai eu envie d’explorer ce sujet au fil de mes innombrables conversations sur les frontières avec plusieurs de mes proches et de mes pairs du milieu universitaire.
Comme je l’écrivais en 2021 dans ma déclaration personnelle de candidature au doctorat :
« Ces cinq dernières années, j’ai vécu dans deux pays et quatre villes. J’étais toujours en processus d’apprentissage et de désapprentissage. J’ai visité l’Argentine, la Barbade, le Chili, la Chine, la Croatie, la France, le Ghana, l’Inde, le Malawi, le Mexique, le Sénégal, la Serbie, le Sri Lanka, le Soudan du Sud, la Gambie, le Paraguay et le Venezuela, sans visa ni billet d’avion, seulement en discutant avec des collègues originaires de ces pays. Ces échanges avec la communauté migrante, dont je fais partie, continuent de m’apporter beaucoup au quotidien. Ils m’amènent à examiner les grands enjeux qui touchent la mobilité transnationale de la main-d’œuvre migrante, surtout celle du tiers monde. Je me suis mise à voir d’un œil critique l’application des lois et politiques internationales, qui varie selon le pays d’origine de chaque personne migrante. Mes rencontres m’ont conduite à passer au crible le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, document soi-disant neutre qui vise en partie à définir un cadre international de gouvernance des migrations. Ces expériences et ces questions m’ont contrariée et forment la base de ma démarche en recherche. »
Au fil des rencontres, j’ai compris que la migration ne se limite pas à traverser les frontières. C’est un échange d’histoires, de visions du monde et de pouvoirs. J’ai donc commencé à m’interroger sur la neutralité du droit international, ses conséquences, son évolution et sa consolidation. Cette prise de conscience continue d’orienter mon travail de recherche. Elle me pousse à explorer les points de vue, les histoires et les réalités genrées propres à l’Afrique comme points d’appui pour encadrer plus équitablement les mouvements de la main-d’œuvre. C’est important, car une telle analyse bouscule le récit voulant que tout le monde soit gagnant dans le système actuel et force les universitaires et les décisionnaires à voir que le droit international est une façon de gérer l’inégalité.
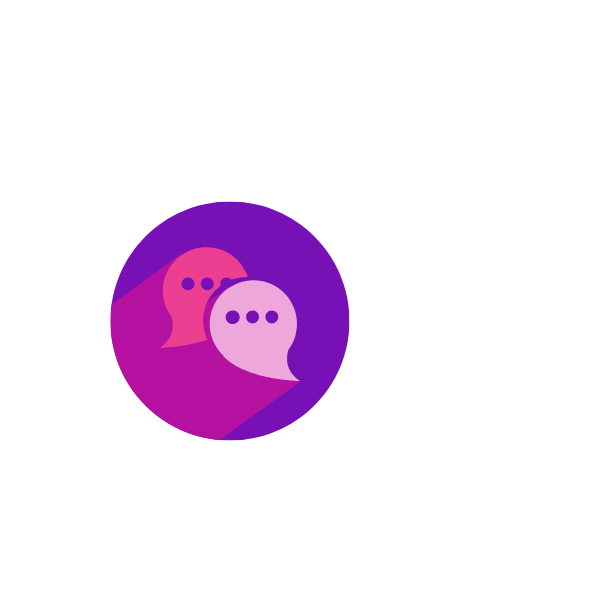
« J’aimerais encourager d’autres personnes (universitaires, autorités, défenseuses et défenseurs des droits) à remettre en question le vocabulaire « neutre » du droit international. »
Christiana Sagay
Qu’espérez-vous que vos collègues en recherche, décisionnaires, praticiennes et praticiens retiennent de vos recherches?
C. S. : D’abord et avant tout, je veux montrer que les ABMO sont plus que des contrats. Ce sont des instruments qui influencent la vie des gens et qui devraient être conçus en fonction de cette réalité. J’espère que mes collègues du monde de la recherche verront que poser un regard postcolonial et féministe sur les ABMO permet de voir les pouvoirs, les exclusions et les possibilités à l’œuvre dans les textes relatifs au droit migratoire.
Quant aux décisionnaires, aux praticiennes et aux praticiens, je leur rappelle que les ABMO peuvent être conçus différemment. Si on écoute la main-d’œuvre migrante, particulièrement les femmes, et qu’on base les accords sur les histoires et les traditions juridiques africaines, on peut adopter des cadres plus équitables, plus pratiques et plus efficaces.
À terme, j’aimerais encourager d’autres personnes (universitaires, autorités, défenseuses et défenseurs des droits) à remettre en question le vocabulaire « neutre » du droit international et à imaginer une gouvernance des migrations qui ne bornerait pas aux intérêts économiques, mais qui serait plutôt axée sur la dignité, le vécu et l’équité. Dans cette optique, j’espère ajouter au dialogue amorcé par de remarquables universitaires qui ont critiqué le système avant moi. Si j’arrive à susciter de nouveaux échanges dans cette lignée, j’aurai atteint mon objectif.
En quoi votre expérience à l’Université d’Ottawa influence-t-elle votre parcours en recherche jusqu’à maintenant?
C. S. : Quand je suis arrivée à Ottawa, j’étais surprise de m’y sentir tout de suite à l’aise. J’espérais ressentir la même chose à l’Université et je n’ai pas été déçue. Intellectuellement, je m’y sens chez moi. Je suis en mesure d’étudier la migration, le droit et la justice tout en restant fidèle à ma propre histoire et à ma vision de la recherche.
Cela dit, ce sont les liens que j’ai tissés et les communautés que j’ai bâties qui ont façonné mon passage à Ottawa. J’ai noué des amitiés durables avec des personnes qui me soutiennent au-delà de toutes mes attentes. Pour moi, c’est un rappel : les idées sont au cœur de la recherche, mais en fin de compte, ce sont les gens autour de nous qui rendent ce parcours possible.
De bien des façons, j’ai trouvé mes repères à l’Université d’Ottawa. J’ai souvent l’impression d’y avoir naturellement déployé mes ailes et suivi les valeurs qui me sont chères : la curiosité, la créativité et l’esprit de communauté.
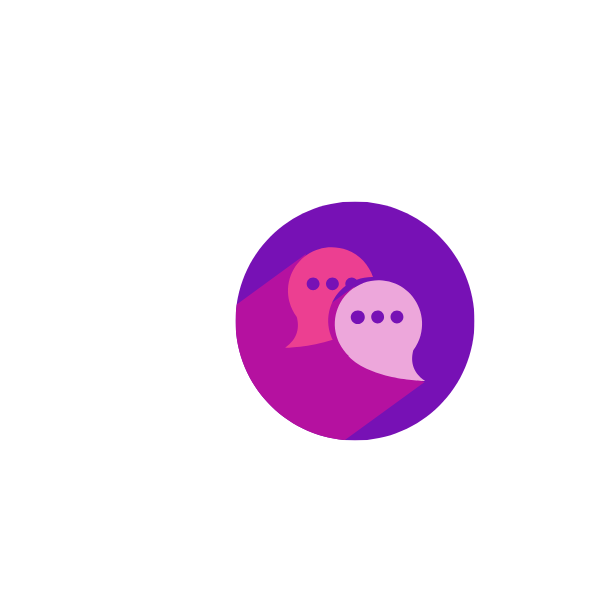
« J’ai noué des amitiés durables avec des personnes qui me soutiennent au-delà de toutes mes attentes. Pour moi, c’est un rappel : les idées sont au cœur de la recherche, mais en fin de compte, ce sont les gens autour de nous qui rendent ce parcours... »
Christiana Sagay
Durant vos études, avez-vous eu l’occasion de collaborer avec des centres ou des réseaux de recherche? Si oui, comment ces expériences ont-elles enrichi votre parcours?
C. S. : Oui, j’ai eu la chance de collaborer avec plusieurs centres et réseaux de recherche qui ont façonné mon parcours et mon sentiment d’appartenance à la communauté. À l’automne 2021, juste avant de commencer mon programme, ma superviseure, la professeure Delphine Nakache, m’a invitée à participer au volet canadien du projet VULNER. J’ai commencé là en tant que chercheuse, puis j’ai rapidement accédé au rôle de coordonnatrice de recherche, où j’ai été plongée au cœur de la collaboration internationale. Du jour au lendemain, j’ai dû gérer des activités de recherche, assurer la liaison avec des partenaires de six autres pays et apprendre, en temps réel, comment gérer un projet de recherche de A à Z. Ce qui a donné vraiment un sens à ce rôle, c’est de savoir que le projet avait un impact direct sur l’expérience dans le système juridique des gens en quête d’une protection au Canada. C’est le genre de projet qui me rappelait pourquoi j’avais choisi le domaine du droit et l’Université d’Ottawa.
Plus tôt cette année, la professeure Nakache a été nommée titulaire de la Chaire de recherche de l’Université sur la protection des personnes migrantes et le droit international. Je collabore avec la Chaire sur trois axes intégrés qui comblent le fossé entre les disciplines et explorent l’effet des politiques nationales et internationales du Canada sur les diverses populations migrantes, notamment les travailleuses et travailleurs temporaires, les étudiantes et étudiants internationaux, les personnes migrantes sans statut, les demandeuses et demandeurs d’asile et les personnes réfugiées. En participant à ces initiatives, j’ai pu approfondir mon expertise et collaborer avec un réseau dynamique de chercheuses, chercheurs, praticiennes et praticiens qui repensent la gouvernance des migrations. J’ai maintenant hâte à la mise en œuvre des prochaines initiatives!
Je suis aussi membre étudiante du Centre de recherche et d’enseignement sur les droits de la personne (CREDP) grâce à la professeure Julie Ada, qui a parrainé mon adhésion, et au professeur Olabisi Akinkugbe, qui nous a parlé en bien, lors de sa visite, de son propre engagement auprès du Centre lorsqu’il était doctorant. Son témoignage a incité beaucoup d’entre nous à s’investir auprès du Centre. De plus, je suis désormais la représentante des étudiantes et étudiants au sein du comité de gestion. Ce que j’aime le plus au CREDP, c’est l’esprit de camaraderie, les discussions animées, les engagements communs et la possibilité d’aborder des questions de droit international de manière approfondie avec des pairs et les professeurs et professeures. J’ai particulièrement aimé mes échanges vifs et brillants avec le professeur John Packer, le directeur sortant, qui m’a poussé à développer mon esprit critique et une conception plus large du domaine du droit international.
Enfin, j’ai collaboré à des groupes de rédaction, à des groupes d’échanges informels sur la recherche et à des réseaux de pairs. Ces projets peuvent sembler modestes, mais ils ont été transformateurs. Ils m’ont aidé à faire évoluer mes idées et à voir mon aventure universitaire comme un parcours collectif, et non solitaire.
Durant vos études, avez-vous participé à des activités d’enseignement, à des publications ou à des conférences? Quelle importance ces expériences représentent-elles?
C. S. : Oui, tout à fait. Toutes ces expériences ont été profondément marquantes pour moi parce qu’elles correspondent à des étapes de progression dans mon parcours universitaire.
Du côté de l’enseignement, j’ai eu l’occasion de donner une conférence sur le droit international de la personne à l’Université d’État de l’Arizona, aux États-Unis. Ce trimestre, je fais le stage en enseignement universitaire, soit la dernière étape vers l’obtention du certificat en enseignement universitaire, dans le cadre duquel je donne trois cours. Pour moi, enseigner c’est beaucoup plus que d’être simplement devant une classe. Je me souviens encore, quand j’étais étudiante en droit, à quel point j’avais un sentiment d’insécurité par rapport à mes propres connaissances. J’hésitais souvent à exprimer mes idées ou à participer à des discussions complexes. Cependant, ce sont les échanges avec mes professeures et professeurs et mes pairs qui m’ont aidé à trouver ma voix. C’est pourquoi aujourd’hui je trouve important de créer un environnement, en classe, où les étudiantes et étudiants peuvent être vulnérables et curieux – points de départ pour bien apprendre.
Ma participation à des publications m’a aussi aidée à trouver ma voix et à la développer. En effet, j’ai cosigné les chapitres de différents ouvrages et, récemment, j’ai contribué (avec ma superviseure) à un chapitre de l’ouvrage Elgar Concise Encyclopaedia of Migration and Asylum Law. J’ai aussi écrit des articles pour la revue TWAIL, et un article qui paraîtra bientôt dans la publication AJIL Unbound. Chaque article est à la fois une façon d’apprendre et une occasion de contribuer à d’importantes discussions qui vont au-delà de la salle de classe.
Ensemble, ces activités enrichissent mon parcours universitaire et elles m’aident à gagner en confiance, à approfondir mes réflexions et à devenir une chercheuse véritablement centrée sur la communauté.
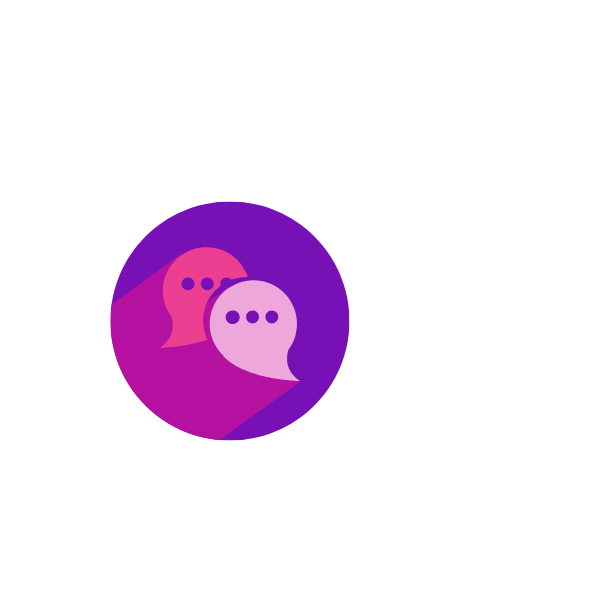
« La partie la plus gratifiante de votre parcours ne sera pas vos résultats, mais la personne que vous deviendrez en cours de route et les liens que vous développerez. »
Christiana Sagay
Quel conseil donneriez-vous à quelqu’un qui envisage des études supérieures en droit?
C. S. : Quand j’ai envisagé, pour la première fois, de faire des études supérieures en droit, je me disais que j’aurais surtout à étudier des textes complexes et à faire de la recherche. En fait, les études en droit nous font évoluer. J’ai appris à trouver ma voix et à définir mes valeurs et ma vision en tant que chercheuse et comme personne.
Alors voici quelques conseils. Si ce n’est pas déjà fait, lisez le livre How to Succeed (and Stay Human) in Law School de la professeure Lynda Collins. Les études supérieures, que ce soit en droit ou non, peuvent ressembler à une compétition pour des notes, des bourses et de la reconnaissance. C’est en partie vrai. Mais parallèlement, il est aussi important de s’ancrer dans nos valeurs humaines pour se rappeler qu’on est beaucoup plus que nos résultats.
Alors, abordez les études supérieures avec curiosité, courage et vulnérabilité, acceptez de ne pas savoir et rapprochez-vous de la communauté. Visez l’excellence, oui, mais ne perdez pas de vue l’être humain en vous. La partie la plus gratifiante de votre parcours ne sera pas vos résultats, mais la personne que vous deviendrez en cours de route et les liens que vous développerez. Lors des jours plus difficiles – et il y en aura –, ces liens vous aideront à avancer.
