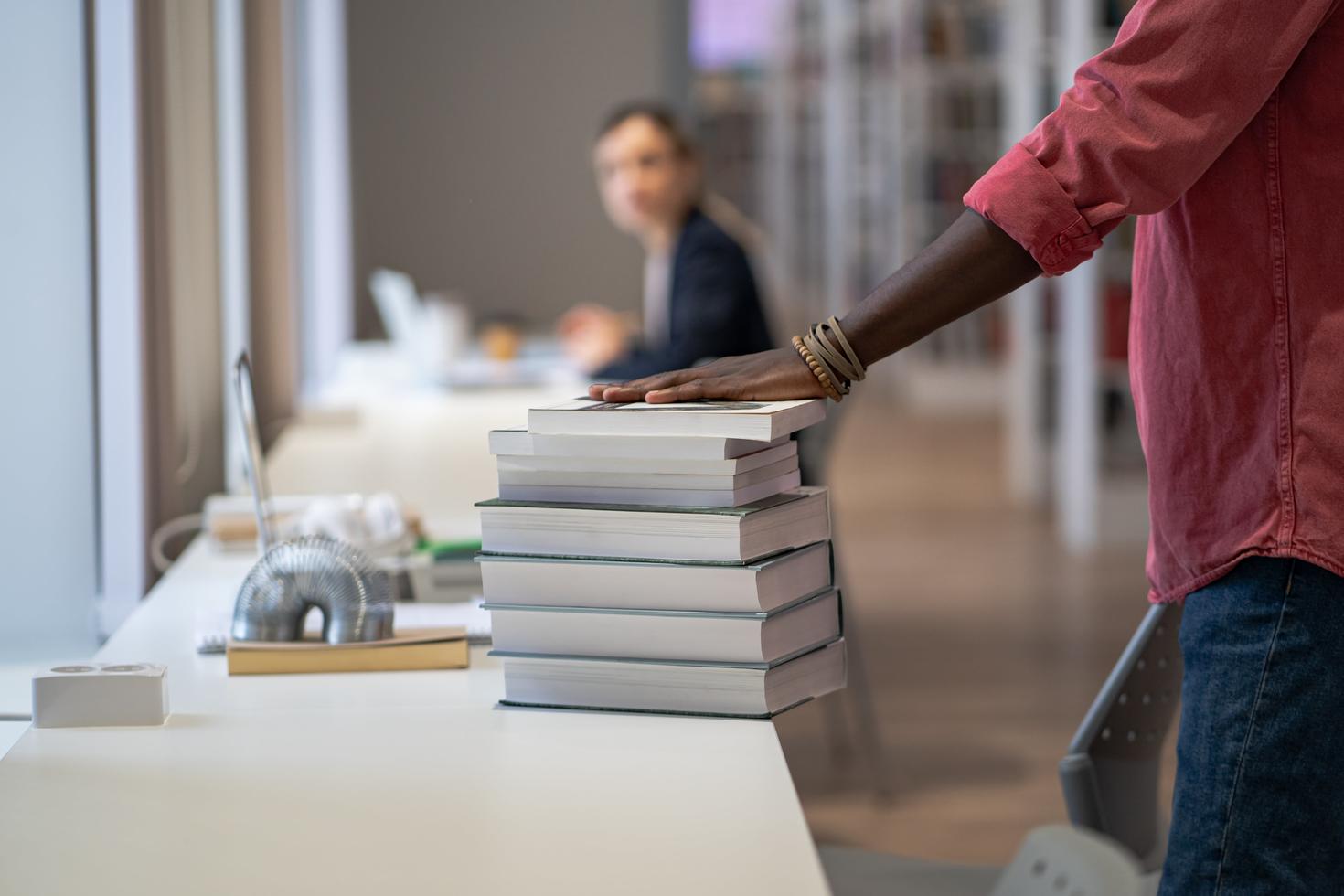J'ai eu l'honneur et le grand plaisir d'assister cette année à la conférence de la Royal Society sur l'avenir de l'édition scientifique à Londres. Cette réunion sur invitation uniquement s'est tenue les 14 et 15 juillet et était présidée par Sir Mark Walport, vice-président et secrétaire aux Affaires étrangères de la Royal Society, ancien conseiller scientifique en chef du gouvernement britannique, un hôte tout désigné pour un événement scientifique rare, qui n'a lieu qu'une fois tous les dix ans. Cet événement revêtait une importance particulière étant donné que la revue phare de la Royal Society, Philosophical Transactions, avait célébré son 350e anniversaire lors de la précédente réunion en 2015.
Un héritage séculaire, et les pressions de l'édition scientifique aujourd'hui
Cet anniversaire marquait plus que le passage du temps. Il commémorait l'invention même de la revue scientifique. La revue Philosophical Transactions a établi un précédent pour les dizaines de milliers de revues savantes qui ont suivi depuis 1665. Rendons-nous en 2025 : à la conférence, les discussions devaient porter sur l'avenir de l'édition scientifique. Or, elles ont surtout porté sur les immenses pressions auxquelles le système de publication universitaire est aujourd'hui soumis.
Sir Mark Walport a ouvert la conférence en avertissant que l'édition scientifique fait face à une tempête parfaite : les revues croulent sous le poids du volume des soumissions et du travail non rémunéré et sous-évalué des évaluateurs, des comités éditoriaux et des rédacteurs en chef. Dans le même temps, les éditeurs continuent d'augmenter leurs profits déjà astronomiques en tirant profit des mandats d'accès libre (OA) et du rôle central que jouent les revues dans les carrières et l'évaluation universitaires. En remplaçant les murs payants par des frais de traitement des articles (APC), les éditeurs ont simplement déplacé les barrières des lecteurs vers les auteurs, renforçant ainsi les inégalités entre les auteurs travaillant dans des régions, des institutions ou des disciplines bien financées et ceux qui sont moins bien financées, au lieu de les résoudre.
Bien que j'aie été profondément impressionné de voir en personne le tout premier numéro des Philosophical Transactions de mars 1665 (il était beaucoup plus petit que je ne l'avais imaginé), il était impossible d'oublier que la plupart des revues prestigieuses d'aujourd'hui restent inaccessibles pour bien des chercheurs, de même que pour le grand public. Célébrer l'héritage des revues est une chose ; reconnaître qu'elles sont devenues à la fois de véritable vaches à lait (des sources de profits faciles) pour les éditeurs commerciaux et qu'elles sont de plus en plus menacées par des absurdités générées par l'IA des recensions de littérature produite par des modèles de langage (LLM) avec des tournures boiteuses, jusqu’à des illustrations de rats aux organes génitaux énormes sous la pression implacable du « publier ou périr », c’en est une autre.
Les frais de traitement d’articles et les ententes « Lire et publier »
La veille même de la rencontre de la Royal Society, le Guardian publiait un article soulevant des arguments semblables, auxquels mes collègues et moi avons répondu par des lettres ouvertes. Comme nous l’avons souligné, nos recherches démontrent que, partout dans le monde, les chercheurs ont payé presque 9 milliards $ US en APC entre 2019 et 2023, répartis entre seulement cinq grands éditeurs, dont les marges de profit avoisinent les 38 %. Ces frais devaient démocratiser l’accès, mais ils ont plutôt canalisé l’argent public vers les poches des entreprises et d’actionnaires, à une échelle impossible à soutenir.
Un autre mécanisme trompeur, ce sont les ententes « Lire & publier » (Read & Publish, ou R&P), qui regroupent dans un seul contrat l’accès par abonnement et les APC, négocié avec une bibliothèque ou un consortium, comme le Réseau canadien de documentation pour la recherche (RCDR/CRKN) qui agit au nom des bibliothèques universitaires canadiennes. Les ententes R&P fonctionnent comme des « Big Deals », enfermant encore davantage les bibliothèques avec les éditeurs sous couvert d’ouverture. Bien qu’on les présente comme une façon de simplifier l’accès libre et d’éliminer les frais facturés aux auteurs, ces ententes masquent les coûts des APC en facturant directement les établissements, verrouillent les institutions dans des contrats à long terme et à coûts croissants et, surtout, renforcent la structure de marché oligopolistique des éditeurs commerciaux, tout en évinçant les investissements dans l’édition menée par les communautés, comme le libre accès diamant.
Les débats récents sur l’instauration de plafonds aux APC, comme ceux annoncés par les NIH, mettent en évidence des risques similaires : bien qu’ils visent à limiter les dépenses de subvention consacrées aux frais de publication, de tels plafonds pourraient encourager un recours accru aux ententes R&P par les plus grands éditeurs commerciaux, renforçant ainsi la concentration du marché et désavantageant les petites revues en libre accès doré y compris celles à but non lucratif qui n’ont pas la capacité de subventionner leurs coûts de la même manière.
Revues menées et gérées par la communauté
Les revues en libre accès diamant sont entièrement gratuites pour les auteurs et pour les lecteurs, n’excluant ainsi personne de la participation au discours scientifique pour des raisons financières. Ces revues fonctionnent généralement sur des infrastructures libres et ouvertes, comme Open Journal Systems (OJS) développé par le Public Knowledge Project (PKP), basé à Vancouver. Les coûts de production des revues, habituellement bien inférieurs à ce que laissent entendre les tarifs actuels des APC, sont assumés par des acteurs académiques tels que les universités, les sociétés savantes, les organismes subventionnaires ou les gouvernements. Le Canada peut être fier de son riche paysage de revues en libre accès diamant, en particulier dans les sciences sociales et humaines, dont plusieurs sont hébergées sur Érudit. Bon nombre de ces revues bénéficient d’un soutien financier du programme d’Aide aux revues savantes du CRSH et démontrent qu’une édition équitable et durable peut prospérer sans barrières payantes.
Ce que les membres de l’ISSP peuvent faire dès maintenant
À mon avis, l’ISSP occupe une position unique à l’intersection de la recherche, des politiques publiques et de l’engagement citoyen. Que vous soyez étudiant aux cycles supérieurs ou professeur titulaire, vous avez un rôle à jouer, que ce soit pour reprendre le contrôle des revues savantes ou pour rendre l’édition scientifique plus transparente et durable. Voici une liste de pistes d’action, selon le stade de carrière et le niveau de risque potentiel pour l’avancement professionnel. Parmi ces 13 gestes, lesquels mettez-vous déjà en pratique et lesquels êtes-vous prêt à entreprendre aujourd’hui?
| Action | Description | Niveau de risque | Public visé | |
1 | Déposer des prépublications | Accélérez la communication scientifique en déposant vos manuscrits sur des serveurs de prépublications (p. ex. arXiv, SocArXiv, Zenodo) lors de ou avant la soumission à une revue. Ajoutez le lien vers la prépublication à votre CV pour y donner accès facilement. | Faible | Tous les stades de carrière |
2 | S’auto-archiver (accès libre vert) | Déposez les manuscrits acceptés dans des dépôts institutionnels pour un accès libre. Ajoutez le lien du dépôt (idéalement un DOI) à votre CV. | Faible | Tous les stades (avec appui de la bibliothèque) |
3 | Refuser de céder vos droits d’auteur | Pratiquez la rétention de droits, par ex. via l’Addenda de l’auteur canadien, pour conserver des droits non exclusifs (auto-archivage, réutilisation en enseignement, dépôts). | Faible | Tous les stades de carrière |
4 | Soumettre à des revues sans but lucratif | Choisissez des revues en libre accès diamant et/ou gérées par des sociétés savantes ou universités, reposant sur des modèles transparents et équitables. | Moyen | Chercheurs en milieu de carrière et expérimentés |
5 | Refuser d’évaluer pour des éditeurs exploitants | Déclinez les invitations à évaluer pour des revues d’éditeurs qui ne reflètent pas les valeurs de votre communauté. Rendez publique votre décision. | Faible | Tous les stades de carrière |
6 | Promouvoir la transparence de l’évaluation par les pairs | Appuyez les revues qui pratiquent ou expérimentent l’évaluation ouverte et rendez publiques vos évaluations lorsque possible. | Faible – Moyen | Tous les stades, plus facile en milieu de carrière et chercheurs expérimentés |
7 | Décliner ou quitter des comités éditoriaux d’éditeurs exploitants | Refuser de siéger à des comités éditoriaux de revues d’éditeurs qui ne reflètent pas les valeurs de votre communauté ou quittez ces postes, si vous en faites déjà partie. Rendez publique votre décision. | Moyen - Élevé | Chercheurs en milieu de carrière et expérimentés |
8 | Soutenir ou lancer de nouvelles revues | Contribuez à des modèles communautaires, comme les revues en libre accès diamant. | Élevé | Chercheurs en milieu de carrière et expérimentés |
9 | Déclarer l’indépendance d’une revue | Discutez avec l’éditeur en chef et le comité éditorial de la possibilité de reprendre le contrôle et de se libérer d’éditeurs exploitants. | Moyen | Chercheurs en milieu de carrière et expérimentés qui sont membres de comités éditoriaux |
10 | Revendiquer la réforme des APC, des ententes R&P et des abonnements | Passez par vos canaux institutionnels (bibliothèque, consortiums comme le RCDR/CRKN) et instances (décanats, vice-rectorats) pour réclamer une réforme des investissements dans l’accès libre. Demandez aussi à votre bibliothèque de soumettre ses données à OpenAPC. | Élevé | Chercheurs expérimentés, direction universitaire |
11 | Rendre publics les coûts d’APC | Déclarez quelle part des subventions a servi à payer des APC ou autres frais de publication. Mentionnez toute exemption ou réduction. | Faible | Tous les stades de carrière |
12 | Encadrer sur l’édition responsable | Formez les chercheurs émergents aux pratiques d’édition durables et fiables. | Faible | Tous les stades (avec appui de la bibliothèque) |
13 | Défendre la réforme de l’évaluation de la recherche | Plaidez pour des changements dans l’embauche, la promotion et la permanence afin de réduire la dépendance au prestige des revues, en ligne avec DORA, CoARAet les principes HELIOS Open. | Élevé | Chercheurs expérimentés, direction universitaire |
Comment créer un avenir meilleur pour l’édition scientifique
L’économie de l’édition savante n’est pas figée : elle découle de choix délibérés, de contrats et d’incitatifs, tant universitaires que financiers. Ces choix pouvaient sembler raisonnables à l’époque où les revues étaient imprimées sur papier et où l’évaluation par les pairs devait s’organiser par courrier postal. Aujourd’hui, ils ne font qu’accentuer les inégalités et canaliser des milliards de fonds publics vers des profits commerciaux.
En parallèle, la culture du « publier ou périr » pousse les chercheurs à prendre des raccourcis pour donner l’illusion de productivité et d’impact, notamment avec l’appui de l’IA générative. Ces raccourcis prennent plusieurs formes — de l’auto-plagiat et de la publication en tranches (« salami publishing ») aux rapports sélectifs, à l’ajout d’auteurs honorifiques ou fantômes et aux cartels de citations. S’y ajoutent les usines à articles (« paper mills »), les revues détournées (« hijacked journals »), ainsi que des évaluations, manuscrits ou analyses entières fabriqués par des modèles de langage. Le résultat est le même : une érosion de la confiance envers la recherche.
Dans le climat politique actuel, marqué par des tentatives de restreindre l’autonomie des universités et par des coupures de financement massives lorsque la recherche entre en conflit avec les agendas gouvernementaux comme on l’a vu en Argentine et aux États-Unis la dépendance des carrières académiques à l’égard de la publication savante, combinée à l’exploitation commerciale, constitue une menace profonde pour l’intégrité de la recherche.
J’invite donc les membres de l’ISSP à montrer l’exemple : faire des choix éditoriaux réfléchis, refuser de subventionner par du travail bénévole des modèles exploitants et militer pour des processus d’évaluation de la recherche qui mettent la qualité, l’accessibilité et l’équité au premier plan. Le prochain chapitre de l’édition scientifique sera écrit par celles et ceux qui choisiront d’agir. J’aimerais voir l’ISSP contribuer à bâtir un avenir où l’édition scientifique sera équitable, durable et portée par la communauté.